Par Lionel LUCOT, vice-président du Rucher du Périgord
Repérer les espèces végétales attirant les frelons asiatiques au printemps et à l’automne facilitera un meilleur piégeage. Certains végétaux sauvages ou cultivés qui nous entourent sont particulièrement attractifs pour les frelons asiatiques qui vont venir s’y alimenter en nectar ou prélever d’autres insectes et nourrir leurs larves.
Tout ce qui sera dit ici est basé sur des observations de particuliers qui ont remarqué que certaines plantes à fleurs attiraient les frelons asiatiques. Cela n’a donc, pour l’instant, aucune valeur scientifique. La liste n’est pas, bien entendu, exhaustive et peut être complétée en fonction d’autres observations faites dans nos jardins.
Une distinction a été opérée entre les espèces végétales à floraison printanière et celles à floraison automnale et hivernale car elle renvoie à un type de piégeage différent.
Espèces végétales : Période de floraison au printemps
- Le camélia japonica qui fleurit de février à avril.

- Le cotonéaster horizontalis rampant qui fleurit d’avril à mai. Il fructifie avec des petites baies rouges.
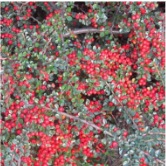
- L’épine-vinette de Thunberg ou berberis thunbergii qui fleurit d’avril à mai.

- Le mahonia : il a une origine commune avec le frelon asiatique ; cela explique son appétence pour ses fleurs jaunes ; le choix du mahonia est fonction de sa floraison qui peut aller d’octobre à mars selon l’espèce ; choisir l’espèce qui fleurit au printemps.

- L’angélique Archangelica qui fleurit d’avril à mai selon les lieux géographiques.

- La sarracenia oreophila : elle est un piège naturel passif car il n’y a aucun mouvement mécanique qui attire le frelon asiatique. Celui-ci est attiré par le nectar et par les phéromones situés sur la lèvre de la plante. En plongeant dans le long tube de la feuille, le frelon asiatique perd pied et glisse comme sur un toboggan grâce à la texture des urnes. Il sera piégé au fond et assimilé par les sucs digestifs de la plante. Une cinquantaine de frelons asiatiques peuvent être digérés par une seule sarracenia. Malheureusement elle attire également l’abeille.

Il ne faut pas oublier l’attractivité des frelons asiatiques pour les fleurs des arbres fruitiers printaniers comme les pruniers, pêchers, cerisiers, pommiers et poiriers pour n’en citer que quelques-uns.
Espèces végétales : période de floraison à l’automne, voire en hiver
- Le mahonia : toutes les catégories fleurissant de l’automne.

- Le néflier du Japon qui fleurit d’octobre à janvier.

- Lierre qui fleurit d’ août à octobre.

- Bignone qui fleurit d’août à octobre.

- Aster qui fleurit de septembre à novembre.
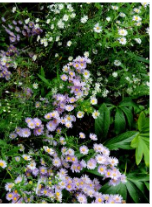
Un collègue du Lot-et-Garonne, Bernard Saligné qui est intervenu avec Madame Garcia à la réunion publique de Lunas le 29 janvier dernier m’a informé récemment que les prunus (floraison printanière) et les chèvrefeuilles d’hiver (floraison hivernale) avait également un pouvoir d’attraction sur les frelons asiatiques.
Nous savons qu’il n’est jamais simple de procéder à un piégeage efficace des frelons asiatiques surtout celui qui vise les reines fondatrices. Cette connaissance empirique des fleurs attirant les frelons asiatiques est certainement d’une grande utilité quand il faut rechercher un emplacement adapté pour les capturer. Les fleurs printanières nous aideront préventivement à piéger les fondatrices et les empêcher de construire un futur nid ; les fleurs automnales permettront le piégeage des ouvrières pour atténuer leur prédation sur les ruches. On pourrait faire remarquer qu’il vaudrait mieux ne pas avoir ces plantes dans son rucher, car elles ne seraient pas là pour attirer les frelons asiatiques. A contrario, ce n’est pas par leur absence que l’on évitera la prédation de cet insecte envahisseur. En réalité, les pièges que l’on placera sur ces plantes viendront compléter les moyens de protection habituels comme les réductions d’entrée des ruches, les diverses muselières, les harpes électriques ou d’autres moyens encore.



